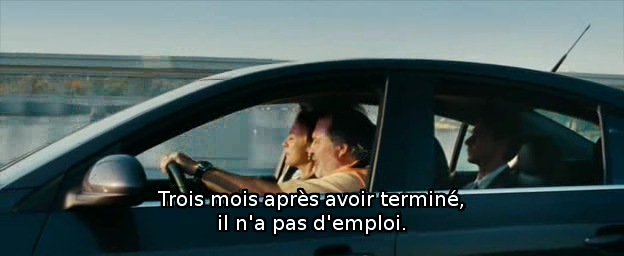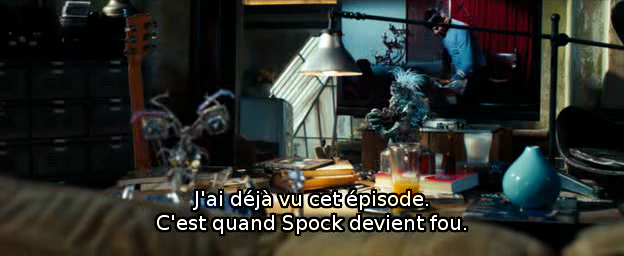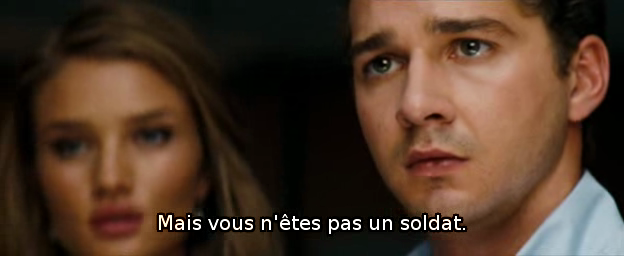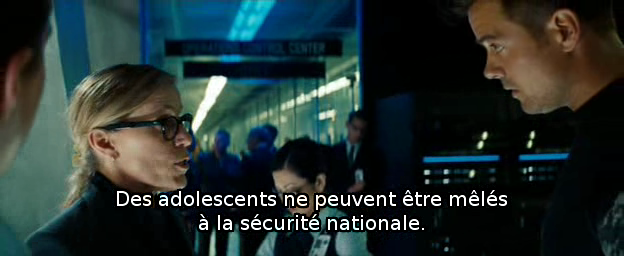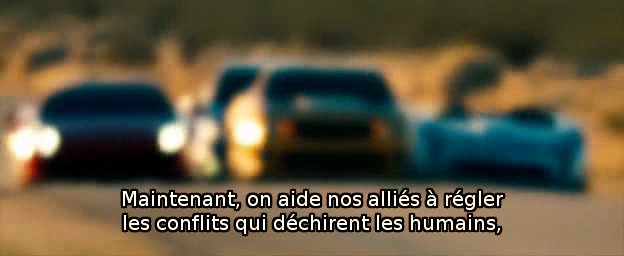Dans une note publiée sur Culture Visuelle et intitulée "Transformers, l'adieu à la fiction", André Gunthert fustige le dernier film en date de Michael Bay, Transformers, La Face cachée de la Lune. A. Gunthert s'interroge sur le déséquilibre entre action et narration et parle même de "renoncement aux ressorts de l'intrigue".
En effet, le film adopte une singulière structure ; il est divisé en deux parties fortement distinctes. La première prend la forme d'une comédie hystérique tandis que la seconde est un exercice de destruction à grande échelle qui prend place dans Chicago, M. Bay faisant pour l'occasion preuve d'une lisibilité peu habituelle dans sa réalisation [le fait d'avoir été contraint de tourner le film en 3D n'y est peut-être pas étranger].
Une telle scission dans le métrage laisse à penser que le film se débarrasse littéralement d'un scénario devenu presque obsolète dans le cinéma de Bay et qu'il trainerait comme un reliquat hérité d'une forme ancienne. Le film appartient pleinement à un nouveau genre de blockbusters, qui place le spectacle au-dessus de tout. Les scènes d'action sont au centre de ce nouveau genre et le reste semble bâti autour dans le seul but d'assurer une certaine continuité entre ces différentes scènes-clés, comme un ciment qui consoliderait l'édifice quitte à sacrifier la cohérence scénaristique. Citons Terminator Salvation, Sucker Punch [Sucker Punch n'appartient pas totalement à cette catégorie, mais la déconnexion totale des scènes d'action avec le reste du film interpelle], Tron Legacy, Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides, Live Free or Die Hard : le nombre de séquelles parmi ces exemples montre la véritable finalité de ces films ; l'exploitation d'une licence.
Dans ce nouveau schéma, le film n'est plus que le dernier maillon, toujours décevant, d'une interminable promotion qui distille teasers, pré-affiches, photos de tournages volées. Les scènes d'action semblent pensées autant pour leur morcellement au sein de teasers - souvent bien plus excitants - que pour leur révélation intégrale dans le film.
[Notons aussi l'apparition de véritables films-teasers, comme tout ceux qui ont annoncé The Avengers. Ce phénomène est la suite d'un processus qui autrefois se contentait de laisser une ouverture possible à une éventuelle suite, sous réserve de succès commercial. Le film n'a plus d'identité qu'au sein d'une galaxie d'autres produits dont il n'est même plus le centre de gravité.]
Dont acte, M. Bay n'a jamais cherché à faire illusion dans ce domaine, mais au-delà de cette constatation, le film se positionne sur quelques points qui agitent l'évolution récente des blockbusters américains. Même à travers les brumes de son mercantilisme acharné et la dissolution de son scénario, il se détache de ce nouveau Transformers des réflexions, notamment sur le devenir du héros au sein de ce nouveau cinéma, sur l'évolution de son identité, y-compris corporelle, et sur le rapport à la narration qu'entretiennent ces films, mélange d'ironie forcée et de culpabilité.
La première partie du film, comédie bouffonne au rythme presque pathologiquement boulimique [récupérant à peu près tout ce que les précédents films ont fait naître comme protagonistes tout en y ajoutant de nombreux autres] tourne rapidement à l'hystérie. Au risque de faire sourire, on pense par moment au cinéma de Joe Dante, dans ces portraits d'adultes, tous dominés par leurs névroses [les parents de Sam qui lui expliquent les difficultés de l'harmonie au sein d'un couple et qui portent dans le même temps un survêtement identique, symbole pathétique d'une fusion forcée où l'individu n'a plus sa place au sein du couple ; Charlotte Mearing qui tique dès qu'on l'appelle madame ; Dutch, le garde du corps de Seymour Simmons qui lors d'une scène d'action se ressaisit brutalement en disant "ce n'est pas moi, c'est l'ancien Dutch" ; ...] et leur individualisme. On perçoit chez eux un grand détachement qui tient de l'aveuglement face à la tragédie qui s'annonce. A la manière de Thor de Kenneth Brannagh, l'écriture du film joue sur le décalage dramatique entre les extraterrestres et les humains ; en fait une non-assomption des enjeux artificiellement boursouflés qui déchirent les Autobots et les Decepticons. Le film ne croit plus en lui-même et joue la carte de l'auto-dénigrement [peut-être [pas...] pour glaner ici ou là le qualificatif de post-moderne].
On pense même à Southland Tales de Richard Kelly, à cette fuite progressive et pratiquement indiscernable de la réalité... un sablier qui se vide, un compte à rebours vers l'apocalypse finale de la seconde partie. Le film est devenue cette matière instable où la fiction ne repose plus sur le principe de suspension consentie de l'incrédulité mais s'effondre sur elle-même, comme un trou noir, soleil dont l'énergie ne suffit plus à compenser la gravitation.
La deuxième moitié irradie le film de sa puissance. Destruction en règle de Chicago [devenue un baroque substitut cinématographique à New York]. M. Bay, le Néron hollywoodien, s'y emploie avec intelligence et brio. Si les deux premiers épisodes donnaient surtout à voir une bouillie numérique illisible, faite de plans trop brefs, concassés par des ralentis de pâles d'hélicoptères (...) [on en retrouve encore dans Transformers 3], cette partie impressionne : l'utilisation de la 3D d'abord, qui tire partie des volumes qu'offrent Chicago, et surtout de la différence d'échelle entre extraterrestres et humains, qui ressemblent dès lors à des souris perdues dans un monde trop grand pour elles, les buildings se transforment en des pièges ludiques, et semblent bâtis à la mesure des Transformers et non des humains. Aux paysages plats et désertiques des deux premiers films répondent la verticalité et la sophistication architecturale de Chicago.
Cette scission du film en deux reflète la séparation définitive de ses deux héros car c'est surtout à travers les figures opposées de Sam Witwicky et Optimus Prime que le film interroge. Comme s'il s'agissait là d'une décantation du cinéma d'action hollywoodien.
Il y a une dualité dans le cinéma d'action américain quant à l'identité du héros moderne et qui s'expose très bien dans ce film : on retrouve d'un côté des héros chétifs voire handicapés (Avatar). Ces héros ont souvent recours à un substitut corporel ou à un compagnon mécanique : des robots, des prothèses mécaniques ou encore à un avatar biologique. Terminator 2 et 3 étaient les prémisses de ce type de héros, où la fragilité du corps de John Connor contrastait avec ceux des terminators chargés de le protéger ou de l'éliminer. [C'est à mon sens une des nombreuses raisons qui font de Terminator Salvation une catastrophe, J. Connor y figurant sous les traits d'un guerrier musclé qui tranche singulièrement avec son allure frêle des films précédents.]
Live Free or Die Hard tentait de reprende à son compte cette alliance entre muscle et cerveau, faisant peu de cas de l'identité antérieure du héros de sa franchise, condamné à n'être plus qu'un bourrin qui alignent les punchlines.
A l'opposé, on voit des films - surtout de super héros - faire l'apologie de corps démesurément musclés, devenus presque une norme : Green Lantern en est l'exemple le plus pathétique, qui promeut un bellâtre décérébré et égoïste au profit d'un exobiologiste dont le seul tort semble de n'être pas physiquement avantageux [dans une scène terrible, le père du biologiste dit en contemplant le héros debout côte-à-côte avec son fils : "dans la vie, il y a ceux qui réfléchissent et ceux qui agissent" en signifiant clairement sa préférence pour la deuxième catégorie]. Dans Thor, le héros bodybuildé doit combattre le destructeur, une machine métallique guidée par son frère Loki, physiquement plus faible.
Le comble est atteint dans le film Captain America, où l'aspect chétif du héros dans les premières minutes nous est littéralement présenté comme un réel handicap, au point qu'il lui est impossible d'espérer s'engager en tant que conscrit *rires*.
Cette bipolarité provient sûrement du besoin de palier à l'impossibilité pour le spectateur de s'identifier à des héros devenus trop inaccessibles ou distants. Si Captain America et Avatar peuvent paraître opposés quant à leur rapport au corps, ils développent pourtant le même principe ; à savoir la métamorphose du spectateur en héros, afin d'entrer pleinement dans la diégèse.
Cette bipolarité provient sûrement du besoin de palier à l'impossibilité pour le spectateur de s'identifier à des héros devenus trop inaccessibles ou distants. Si Captain America et Avatar peuvent paraître opposés quant à leur rapport au corps, ils développent pourtant le même principe ; à savoir la métamorphose du spectateur en héros, afin d'entrer pleinement dans la diégèse.
[Le film Real Steel, pas encore vu, semble être une pièce intéressante de cette opposition en cours. Tout comme le film Surrogates de Jonathan Mostow, déjà réalisateur du beau Terminator 3 ou le film Kick-Ass]
"My hero needs to wake up" - ce sont les premiers mots prononcés après l'introduction expliquant le crash d'un vaisseau extraterrestre sur la face cachée de la Lune (...). Cette phrase est typique de tout le propos qui va parcourir le film par la suite. Là où la compagne de Sam va s'acharner à le considérer comme un héros, à contrario d'autres ne cessent de lui répéter qu'il n'est pas un soldat. Le héros d'aujourd'hui est-il un soldat, un guerrier ? La question peut paraître sans intérêt, mais posée dans un film comme Transformers, elle en devient presque rassurante.
Le traitement de Sam par les autres démontre son statut ; ainsi juste après avoir prononcé la phrase ci-dessus, Carly lui offre une peluche et lui demande s'il a besoin d'argent pour son déjeuner. Elle le quittera plus tard lorsqu'il essaiera de s'opposer à l'invasion.
Ses parents l'infantilise tout autant et l'emmène faire une humiliante tournée d'entretiens d'embauche tout en palabrant sur lui comme s'il n'était pas là. Le mutisme de Sam, l'utilisation de la voiture parentale pour cette scène et la disposition des personnages au sein de l'habitacle en respectant la "hiérarchie" familiale classique renforce très fortement cette impression.
Sam aspire à être valorisé et aimerait pouvoir aider les Autobots à défendre la Terre, mais il est mis de côté par les autorités et les seuls Transformers qui traînent avec lui sont les petits, qui font plus penser à des animaux de compagnie ou à des geeks qu'à des guerriers.
Son ami Autobot Bumblebee est très maternel avec lui, dans deux scènes différentes, il l'attrape dans une main à la manière de King Kong et Ann Darrow, avant de se transformer en voiture afin de le mettre à l'abri dans l'habitacle (ou sur le capot) tandis que Sam pousse des cris aigus assez peu virils. Ce geste évoque un retour au sein de la matrice.
A l'opposé, Optimus Prime apparaît comme la figure parfaitement accomplie du héros [dans le deuxième film de la série, il mourrait pour être ressuscité à la manière du Christ (...)]. Mais ici son côté moralisateur et son engagement semblent complètement hors de propos tant ils sont en décalages avec le reste du film. Optimus Prime martèle ses sentences vindicatives avec une solennité d'autant plus mal venue que leur contenu politique cadre très peu avec le contexte géopolitique du monde en 2011 [la séquence des voitures américaines qui avancent contre le barrage des soldats du Moyen-Orient est édifiante].
Comme le soldat américain moyen qu'on interroge sur les raisons de son engagement, Optimus Prime est obsédé par la notion [pleine de vacuité dans sa bouche] de liberté (qu'il oppose à la tyrannie).
Pour signifier l'engagement d'Optimus, on fait appel à des images très symboliques de l'Amérique, dont l'inévitable destruction de la statue du Lincoln Memorial ou les statues des pères fondateurs, dressées en contre-plongée pendant la riposte des Autobots et des soldats américains à Chicago :
De fait, il est difficile de savoir dans quelle mesure les auteurs du film moquent réellement Optimus Prime [Steven Spielberg, producteur du film, dans son War of the worlds utilisait un plan semblable d'une statue des pères fondateurs, pourtant le sens politique en était complètement différent tant le film condamnait lourdement la politique extérieure agressive des États-Unis, les statues étaient alors utilisées pour rappeler quelles étaient les valeurs sur lesquelles le pays s'était bâti, mais les visées politiques de M. Bay semblent assez éloignées de celle de S. Spielberg]. Tout du moins peut-on se réjouir que ce genre de grosses machines laissent encore la place à une ambigüité.
On a presque le sentiment que ce sont là deux films qui se confondent mais se croisent assez rarement, avançant en parallèle chacun de leur côté ; dans deux travellings jumeaux, on voit Sam et Optimus Prime avancer face au danger dans un ralenti mythifiant. Comme s'ils n'appartenaient plus vraiment à la même diégèse, ils ne coopèrent ou n'interagissent pratiquement jamais dans le film ; chacun menant sa propre quête [les présences disjonctées de Frances McDormand et de John Turturo [ou encore John Malkovich], plutôt habitués des films des frères Coen, renforcent ce sentiment de diégèses multiples, leurs personnages sont complètement déconnectés, cf la scène post-générique qui pastiche Casablanca].
Sam, obsédé par son statut, sert de réceptacle à l'identification d'un public qui ne pourra en aucune manière se projeter sur Optimus Prime, personnage fanatique. Il est finalement lui aussi le reliquat d'une ancienne forme de cinéma ; un héros christique, absorbé par sa quête, dénué de toute forme d'humour ou de second degré, de tout individualisme cynique. [Un décalage de "noblesse" entre les deux personnages qu'illustre bien leur différence de taille.]
On a presque le sentiment que ce sont là deux films qui se confondent mais se croisent assez rarement, avançant en parallèle chacun de leur côté ; dans deux travellings jumeaux, on voit Sam et Optimus Prime avancer face au danger dans un ralenti mythifiant. Comme s'ils n'appartenaient plus vraiment à la même diégèse, ils ne coopèrent ou n'interagissent pratiquement jamais dans le film ; chacun menant sa propre quête [les présences disjonctées de Frances McDormand et de John Turturo [ou encore John Malkovich], plutôt habitués des films des frères Coen, renforcent ce sentiment de diégèses multiples, leurs personnages sont complètement déconnectés, cf la scène post-générique qui pastiche Casablanca].
Sam, obsédé par son statut, sert de réceptacle à l'identification d'un public qui ne pourra en aucune manière se projeter sur Optimus Prime, personnage fanatique. Il est finalement lui aussi le reliquat d'une ancienne forme de cinéma ; un héros christique, absorbé par sa quête, dénué de toute forme d'humour ou de second degré, de tout individualisme cynique. [Un décalage de "noblesse" entre les deux personnages qu'illustre bien leur différence de taille.]